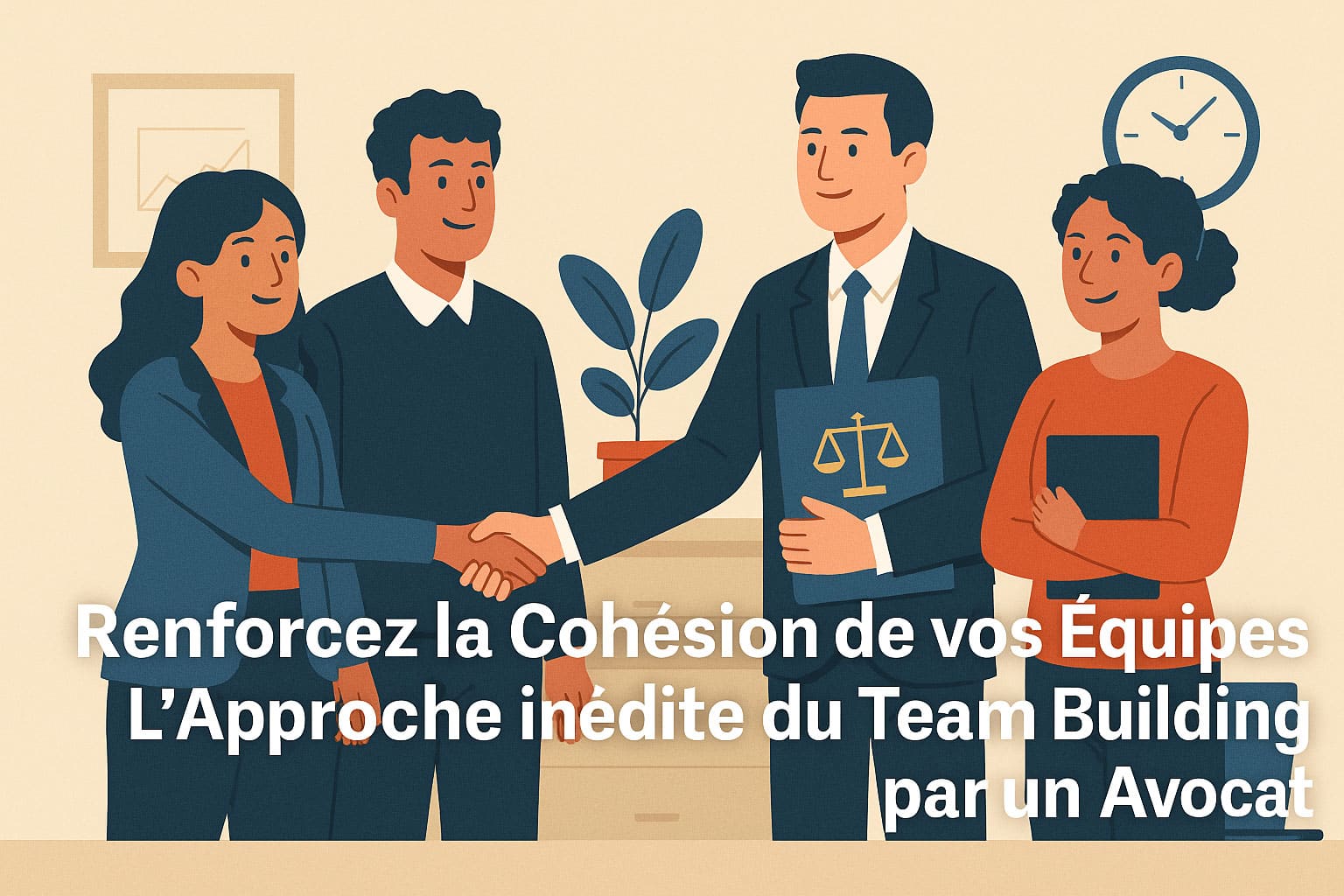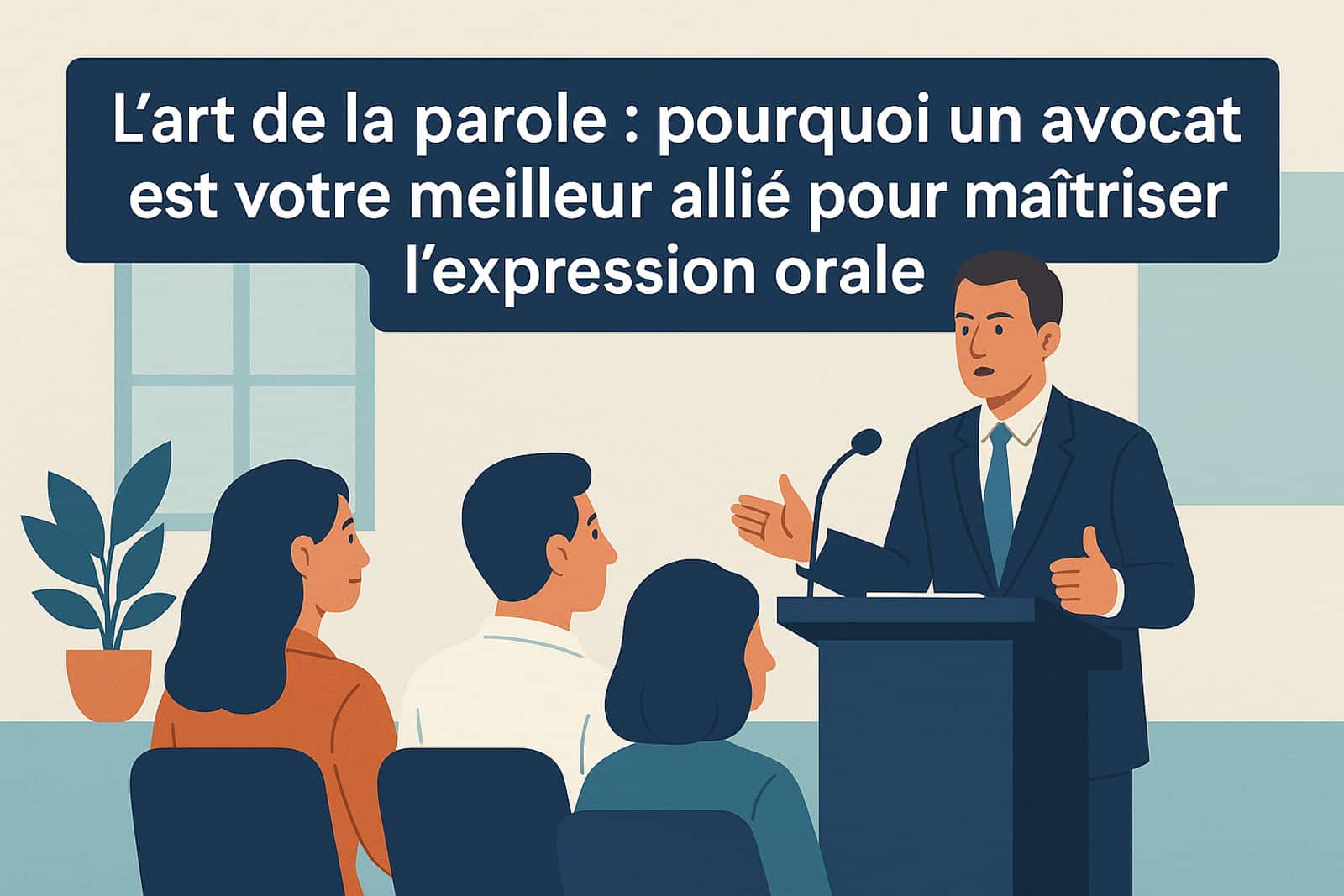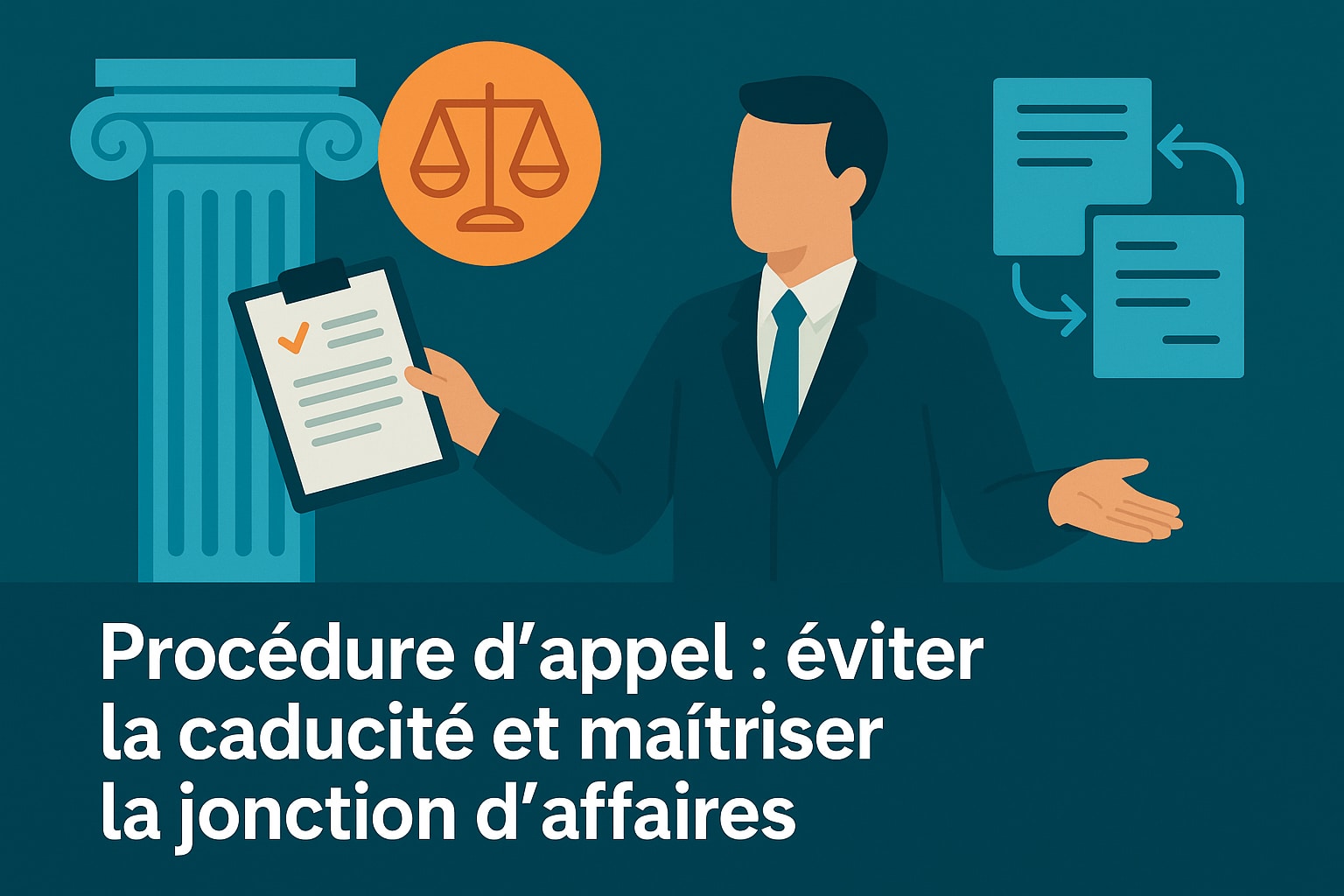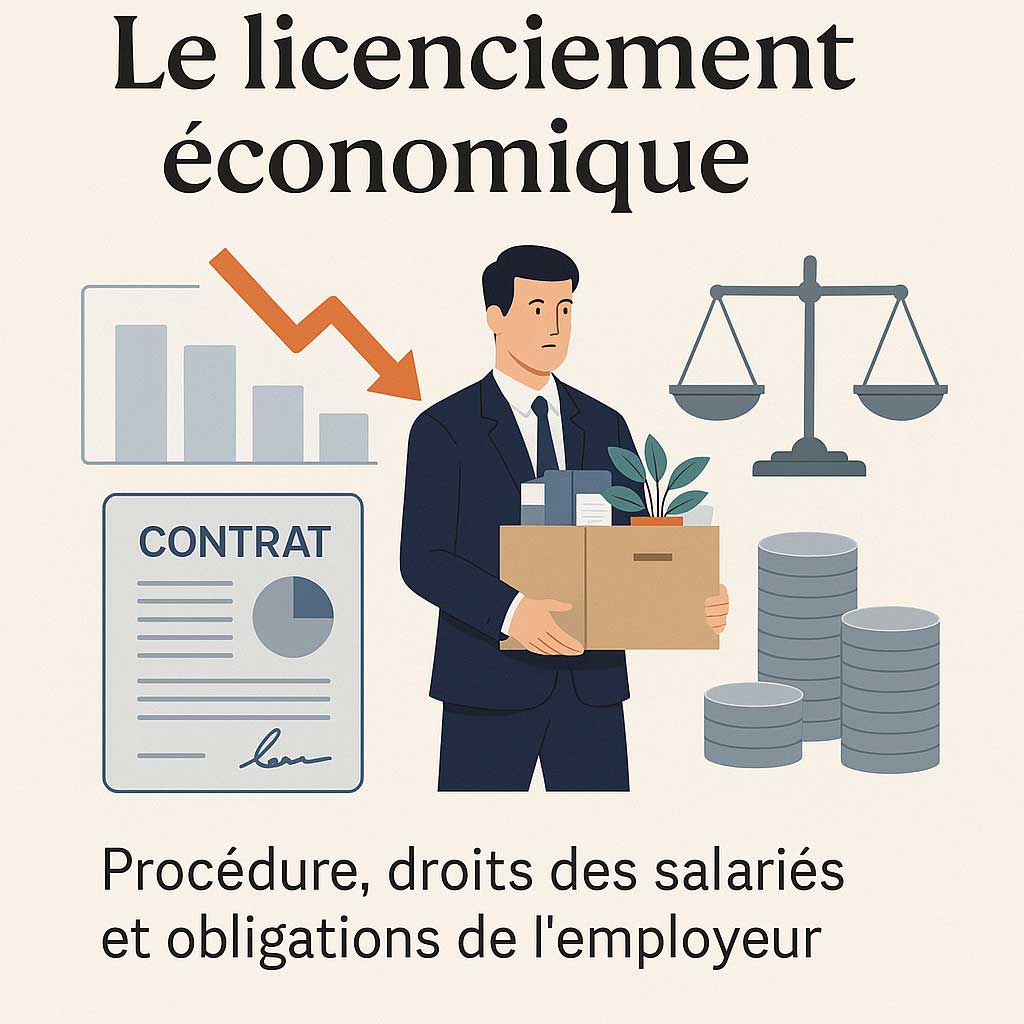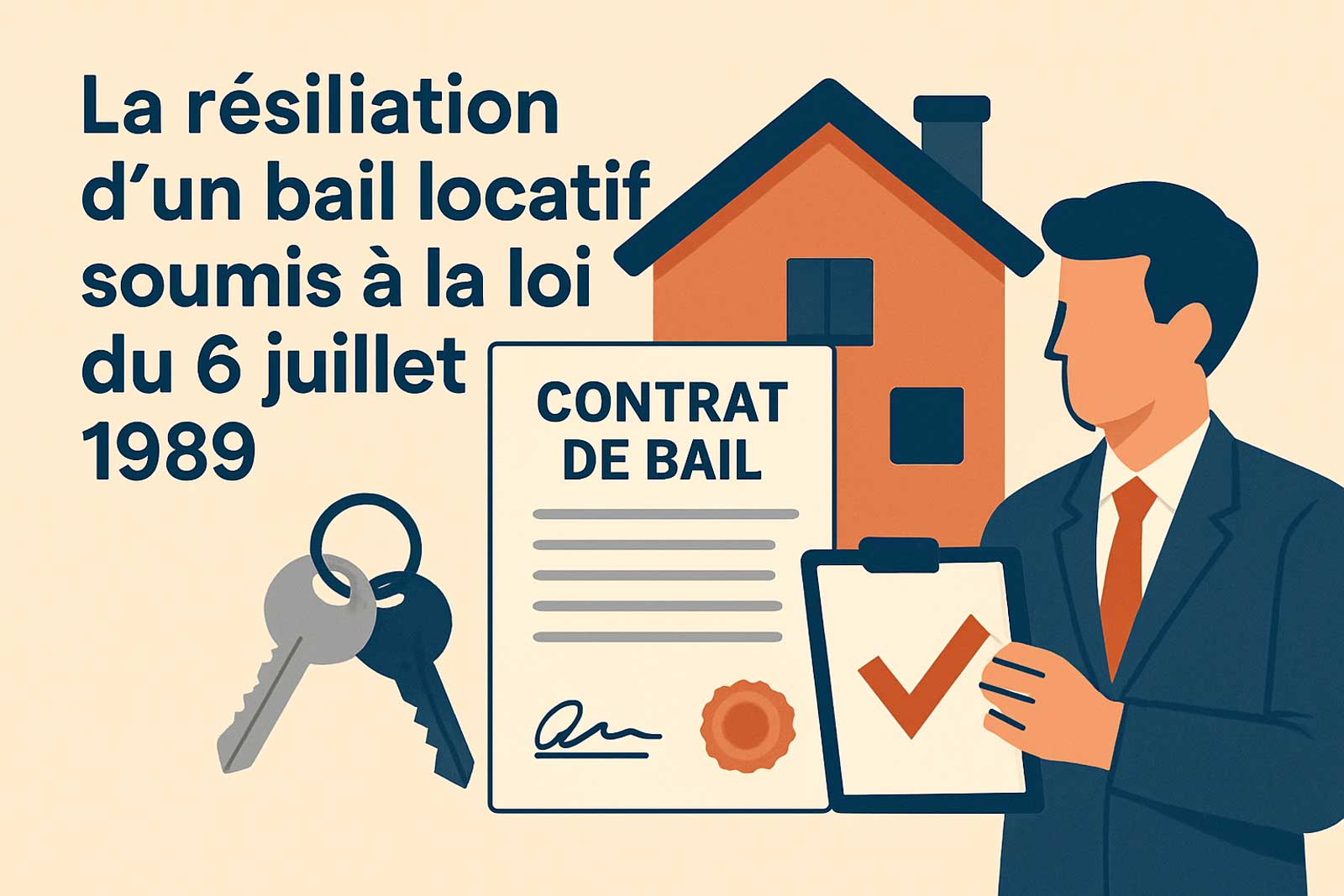Renforcez la Cohésion de vos Équipes : L’Approche Inédite du Team Building par un Avocat
Dans un monde professionnel où la performance collective est essentielle, la cohésion d’équipe devient une priorité stratégique.
Bien que les entreprises investissent dans des activités de team building, beaucoup peinent à dépasser le simple divertissement. C’est ici qu’intervient une approche novatrice et efficace portée par Maître Maxence Genty, avocat.
L’Originalité : Quand la Rigueur Juridique Rencontre la Dynamique Humaine
Faire appel à un avocat pour animer un team building peut surprendre. Mais c’est précisément ce décalage qui fait la force de la méthode.
Maître Genty transpose ses compétences juridiques – communication, écoute active, gestion de conflits – au service des dynamiques d’équipe.
🕐 Durée du programme : 2 à 3 heures
🎯 Objectif : créer une expérience fluide, efficace et participative
🔁 Progression logique :
- Exercices de brise-glace,
- Jeux d’attention,
- Activités de mémorisation et réactivité.
🧱 Des Ateliers Conçus pour Révéler et Construire
La méthode se démarque par l’utilisation d’exercices créatifs et stimulants :
- Association d’idées : pour explorer l’imaginaire de chacun,
- Construction d’une histoire collective : collaboration concrète,
- Communication non verbale : prise de conscience et cohésion,
- Arbitrage d’un conflit : mise en situation pour apprendre à gérer un désaccord avec hauteur et méthode.
🎯 Ces ateliers permettent de renforcer la confiance, de développer l’intelligence collective, et d’ancrer les apprentissages.
Des Bénéfices Durables pour l’Entreprise
Au-delà de la formation elle-même, les résultats sont concrets :
- ✅ Communication améliorée : meilleure écoute et expression entre collègues,
- ✅ Gestion des conflits : outils pratiques et réutilisables,
- ✅ Cohésion renforcée : liens profonds entre collaborateurs,
- ✅ Créativité stimulée : décalage productif du cadre de travail.
✅ Conclusion
Choisir un team building animé par un avocat, c’est :
- Miser sur l’intelligence collective,
- Combiner jeu et rigueur, créativité et structure,
- Investir dans le capital humain avec des outils concrets pour bâtir des équipes performantes et résilientes.
Découvrez nos autres ressources
Ces contenus sont en lien direct avec les enjeux abordés dans cet article :
- 🔗 Expression orale en entreprise : pourquoi faire appel à un avocat formateur ?
Améliorer la parole, la posture et l’impact en public. - 🔗 Cohésion et droit dans le cadre du bail locatif
Comprendre comment la gestion humaine et juridique s’entrecroisent dans d’autres domaines. - 🔗 Les différentes garanties légales en matière de construction
Anticiper les conflits grâce à un cadre clair et structuré.