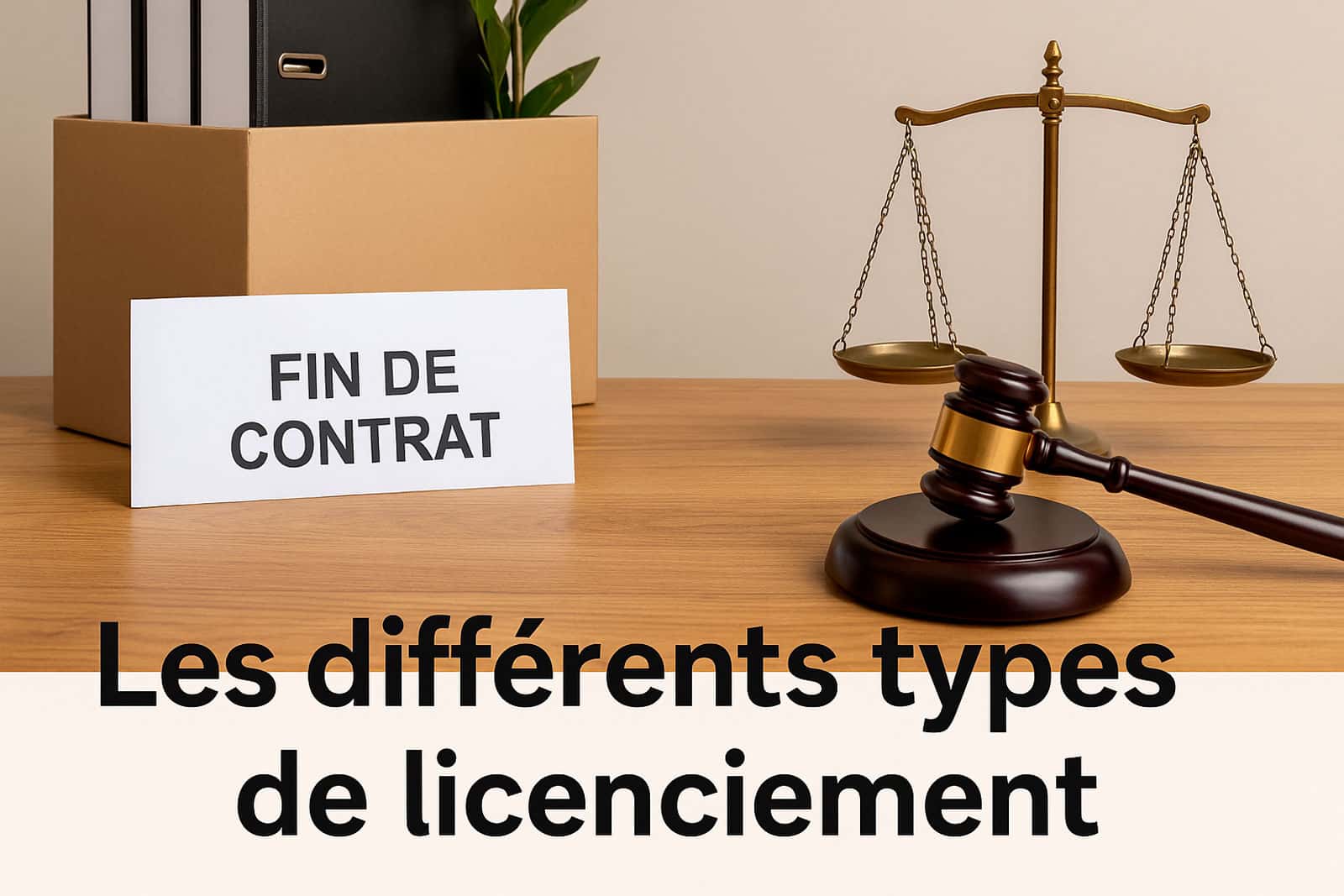Instituée par la loi du 23 juin 1999 et définie à l’article 41-2 du Code de procédure pénale, la composition pénale est une mesure dite « alternative » aux poursuites que le Procureur peut proposer en présence d’une infraction de gravité moindre.
En effet, la composition pénale ne peut être mise en œuvre que pour les délits qui sont punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (article 41-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale). La procédure de composition pénale est également applicable à toutes les contraventions, sous réserve de quantum de peine tel que prévu par l’article 41-3 du Code de procédure pénale.
En toute hypothèse, l’aveu de culpabilité est un prérequis indispensable à cette procédure : elle suppose donc que l’auteur reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et accepte la composition pénale.
La personne se voyant proposer la composition pénale par Procureur de la République conserve la possibilité de la refuser. En cas de refus, le Procureur peut alors mettre en œuvre l’action publique et déférer le mis en cause devant le tribunal correctionnel.
Le Procureur propose une peine, qui peut consister, notamment, en une amende, en une obligation de réparer le dommage causé par l’infraction, d’accomplir un stage de sensibilisation, en une, ou plusieurs interdictions dont la durée maximale ne peut excéder six mois mais également l’obligation de résider hors du domicile conjugal (article 41-2 du Code de procédure pénale).
La proposition de peine est portée à la connaissance du mis en cause par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire et se déroule le plus souvent dans une Maison de justice et du droit en présence d’un délégué du Procureur de la République.
La ou les peines proposées sont exposées dans un procès-verbal de proposition pénale. Le mis en cause dispose alors d’un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître sa réponse. Il dispose bien évidement de la possibilité de se faire assister par un avocat dès ce stade de la procédure qui pourra le conseiller utilement sur l’opportunité d’accepter – ou de refuser le cas échéant – la composition pénale.
En cas d’acceptation, le Procureur saisit par requête le Président du tribunal judiciaire afin de faire homologuer la composition pénale. L’ordonnance validant la composition la composition éteint l’action publique et donne force exécutoire aux peines proposées.
Ce faisant, les victimes d’une infraction dont l’auteur se voit proposer une composition pénale disposent de droits dans le cadre de cette procédure alternative, qui sont souvent méconnus par ces dernières et rarement mis en œuvre, de surcroît lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’assistance d’un avocat.
La victime bénéficie naturellement du droit à obtenir la réparation de son préjudice (I) mais surtout, elle a la possibilité de demander au Juge de ne pas homologuer l’ordonnance pénale et de renvoyer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel (II).
I / Le droit d’obtenir la réparation de son préjudice
Aux termes de l’article 41-2 alinéa 21 du Code de procédure pénale :
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. »
Il résulte ainsi de cet article que le législateur a souhaité préserver le droit de la victime à obtenir la réparation de son préjudice. Dans la philosophie de ce que connaît la justice dite « réparative », il a été reconnu comme mode de réparation du préjudice la réparation du bien endommagé par la commission de l’infraction.
Au-delà d’une indemnisation strictement pécuniaire, le Procureur peut également formuler, afin de protéger la victime d’une réitération de l’infraction à son encontre, les interdictions suivantes :
- ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
- ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles.
En toute hypothèse, et si la réparation n’a pas déjà été réalisée, il est fait obligation au Procureur de formuler une proposition de réparation et de porter à la connaissance de la victime la nature de cette proposition.
Toutefois, dans le cadre stricto-sensu de la composition pénale, la victime ne dispose pas de la faculté à se constituer partie civile. Elle conserve la possibilité de formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’elle a subi.
La pratique judiciaire permet d’observer que les montants allouer dans ce cadre demeurent assez faibles, et ne dépassent que très rarement les 1.500 euros.
La victime conserve également la possibilité de demander au Procureur la citation de l’auteur des faits devant le tribunal afin de lui permettre de se constituer partie civile. Dans ce cas de figure, seul l’examen de la demande des intérêts civils est examiné par le juge.
II / La possibilité de solliciter auprès du Juge le refus d’homologation de l’ordonnance et le déferrement de l’auteur devant le tribunal correctionnel
Il sera rappelé que lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, l’alinéa 27 de l’article 42-1 du Code procédure pénale prévoit que le procureur de la République saisisse par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat.
Il dispose de la faculté de refuser de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
C’est ainsi que si la victime estime que la composition pénale n’est pas une orientation justifiée de la procédure eu égard à la gravité des faits dont elle a été victime, elle dispose de la possibilité d’en informer le juge homologateur.
Cette information peut être portée à sa connaissance lors de l’audition de la victime, mais également en adressant un courrier à ce magistrat. Le recours à un avocat s’avérera particulièrement nécessaire dans cette hypothèse. L’avocat se chargera ainsi de rédiger ce courrier à l’attention du juge homologateur dans lequel il pourra développer les arguments de faits et de droits qui le conduise à solliciter le refus de l’homologation de la composition pénale et le déferrement de l’auteur devant le tribunal correctionnel.