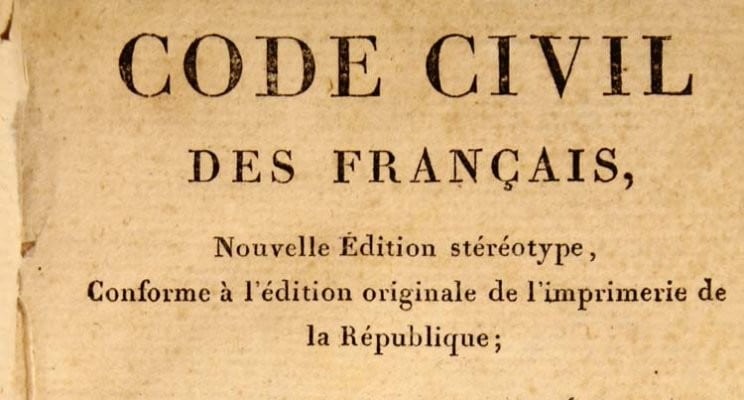
Nous avons vu dans un premier volet les apports désormais largement commentés de la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en droit des contrats. Mais l’objet de cette réforme ne se limite pas uniquement au droit des contrats, puisque bien des aspects majeurs concernent le régime général des obligations. Nous allons ici nous attraire à analyser ces principaux changements.
1. Les obligations conditionnelles
Le législateur a opté pour une simplification du système en abandonnant la classification des conditions traditionnellement découpées comme suit :
– casuelle
– purement ou simplement potestative
– mixte
Il donne à l’article 1304 du code civil une définition générale de l’obligation conditionnelle :
« L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. »
L’article 1304-1 rajoute que la condition doit être licite sous peine de nullité, mais il n’exige pas la possibilité de la réalisation de la condition, aussi ce critère de l’ancien article 1172 du code civil disparait. Si la condition est impossible celle-ci sera donc défaillante et non plus nulle.
La distinction entre condition suspensive et condition résolutoire est maintenue. Toutefois leur périmètre est modifié.
Sous l’emprise de l’ancien article 1181 la condition suspensive était celle qui dépendait ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans cette seconde hypothèse l’obligation avait effet rétroactif du jour où la condition s’était réalisée et non du jour où les parties l’avaient connue.
Désormais ce n’est plus le cas, la condition suspensive est uniquement celle dont la réalisation rend l’obligation pure et simple, la rétroactivité de l’obligation ayant disparu sauf convention contraire.
La condition résolutoire est celle qui par sa réalisation entraine l’anéantissement de l’obligation. Elle demeure rétroactive comme sous l’ancien régime sauf selon l’article 1304-7 volonté contraire des parties ou pour les contrats à exécution successive.
Les conditions potestatives, bien qu’elles ne fassent plus partie de la classification des conditions, demeurent à l’article 1304-2. Si celles-ci sont toujours sanctionnées par la nullité, une exécution en connaissance de cause de l’obligation vient cependant désormais lever la nullité.
La condition se distingue de l’obligation à terme qui diffère l’exécution de l’obligation à un évènement futur et certain alors que pour cette première l’évènement est incertain. Pour l’obligation à terme si la date de l’évènement est incertaine, sa réalisation elle l’est, comme à titre d’exemple l’est le décès. Il est à noter que désormais il y a une séparation claire entre le terme suspensif traité dans la partie du régime général des obligations et le terme extinctif traité dans celle de la durée du contrat.
2. La cession de créance et la cession de dette
La cession de créance n’est plus traitée avec la vente mais est intégrée aux dispositions relatives au régime général des obligations (articles 1321 à 1326). La principale nouveauté concerne l’opposabilité de la cession de créance. L’article 1690 qui imposait une signification par voie d’huissier ou une acceptation par acte authentique disparait pour laisser la place à un régime beaucoup moins lourd et onéreux pour le créancier cessionnaire.
Désormais le transfert de la créance est opposable dès la date de l’acte (article 1323, alinéa 2) sauf si le transfert porte sur une créance future, dans ce cas là il s’opère non pas à la date de l’acte mais à la naissance de la créance (1323).
En contrepartie de cette simplification l’écrit est désormais imposé en tant que formalité ad validitatem, son non-respect entrainant la nullité de l’acte. Par ailleurs pour que la cession produise effet, il faut que le débiteur en ait pris acte, qu’elle lui ait été notifiée, ou qu’il y ait consenti.
Rappelons que le consentement du débiteur cédé n’est aucunement une condition de validité de la cession de créance, toutefois si le débiteur a consenti à la cession cela suppose nécessairement qu’il en a eu connaissance ce qui suffit à lui rendre la cession opposable.
L’autre nouveauté est la création de la cession de dette (article 1327 à 1328-1).
Celle-ci constitue un contrat tripartite dans lequel il faut évidemment l’accord du débiteur originel et du débiteur substitué mais également celui du créancier. Ce dernier peut donner son accord par avance mais dans ce cas là, pour lui être opposable la cession devra lui être notifiée ou il devra en prendre acte.
Le débiteur originel et le débiteur substitué sont en principe tenus solidairement de la dette vis-à-vis du créancier (article 1327-2) sauf à ce que celui-ci libère expressément le débiteur originel. Enfin le créancier peut, sans libérer le débiteur originaire, consentir à ce que la solidarité soit écartée, l’obligation devenant alors conjointe et le créancier devant alors diviser ses recours, sauf si la dette est indivisible auquel cas la solidarité en peut-être écartée. Ce mécanisme consiste en réalité en une cession partielle de la dette.
3. L’extinction de l’obligation
L’article 1342-10 vient désormais régler la question de l’ordre du paiement des dettes en cas de pluralité de celles-ci envers un même créancier. Le principe est la liberté du débiteur de choisir celles dont il entend s’acquitter, à défaut les dettes échues seront payées en priorité, puis les dettes qu’il a le plus intérêt à régler puis en cas de même intérêt à les régler les dettes les plus anciennes. Enfin si toutes les dettes sont égales l’imputation est proportionnelle.
L’article 1343 vient ensuite consacrer une disposition spécifique pour les sommes d’argent et nous confirme qu’il n’y a pas de variation de la somme due en fonction de la valorisation de la monnaie sauf s’il y a indexation ou s’il s’agit d’une dette de valeur.
Le paiement demeure quérable par principe (1342-6) toutefois le champ des exceptions est désormais si large que l’on peut s’interroger si le principe n’est pas inversé car la loi, les parties ou même le juge peuvent décider le contraire.
Si les deux premières exceptions sont logiques, la troisième en revanche laisse supposer que la quérabilité du paiement n’est plus un principe qui s’impose au juge mais plus une consigne qu’il apprécie en fonction des circonstances. Or, dans la mesure où les évolutions technologiques permettent désormais des échanges dématérialisés d’argent on peut s’interroger sur la force du principe de quérabilité.
Le législateur vient également consacrer la pratique des mises en demeure tant du débiteur que du créancier
La mise en demeure du débiteur de rendre définitivement l’obligation exigible et faire courir les intérêts légaux (1344-1). La mise en demeure du débiteur peut prendre la forme d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante selon l’article 1344, mais ni la sommation ni l’acte ne sont définis d’après cet article, aussi la définition de la mise en demeure est incomplète.
La mise en demeure du créancier, plus novatrice, est définie à l’article 1345 et vise la situation où un créancier ne veut pas recevoir le paiement du débiteur. Avant la réforme le créancier n’était pas obligé d’accepter le paiement si celui-ci n’était pas total, et même lorsqu’il l’était il pouvait le refuser et la somme devait alors être séquestrée par le débiteur jusqu’à ce qu’elle soit encaissée par le créancier.
Désormais les articles 1345 et suivants prévoient une solution plus simple puisque si le créancier refuse le paiement qui lui est fait sans juste motif, il pourra lui être fait mis en demeure de l’accepter, et s’il ne l’a toujours pas fait deux mois après la mise en demeure la somme sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations ou si l’obligation porte sur la livraison d’une chose elle sera séquestrée chez un gardien professionnel, ce qui libère le débiteur de son obligation.
L’intérêt de la mise en demeure du créancier est qu’elle interrompt le cours des intérêts dus au créancier et met les risques à sa charge, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur sans pour autant interrompre la prescription.
4. La subrogation
L’ancien article 1251 prévoyait 5 cas de subrogation légale, c’est-à-dire de subrogation de plein droit : le créancier payant un autre créancier privilégié, l’acquéreur de l’immeuble payant les créanciers du vendeur, le codébiteur ayant payé la totalité de la dette, l’héritier payant les dettes de la succession de ses propres deniers et celui qui a payé les frais funéraires pour le compte de la succession de ses propres deniers.
Désormais et il s’agit d’une innovation importante, la subrogation légale est généralisée par l’article 1346 et ne se limite plus aux hypothèses précitées, mais s’applique au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie le créancier.
Dès lors la subrogation conventionnelle n’a plus lieu d’exister car la subrogation légale permet désormais d’inclure tous les cas, mais pour des raisons de sécurité juridique le législateur l’a cependant maintenue à l’article 1346-1, celle-ci devant être expresse et l’écrit devant exister avant le paiement.
La réforme apporte également un autre cas de subrogation intéressant à l’article 1346-2, celui dans lequel ce n’est pas un tiers qui est à l’origine de la subrogation mais le débiteur lui-même qui, empruntant à une tierce personne pour payer son créancier, va permettre à celui-ci d’être subrogé dans les droits du créancier originel. Une telle subrogation n’est toutefois pas généralisée, elle est nécessairement conventionnelle, elle doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
5. La compensation
On a désormais une définition générique de la compensation à l’article 1347 du Code civil : » la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personne »
Si celle-ci conserve sa rétroactivité à la date où ses conditions étaient réunies, la réforme introduit cependant une nouveauté : elle doit être invoquée.
Désormais donc, la compensation n’a plus d’effet automatique. Son invocation est une manifestation de volonté qui devra donc répondre aux conditions générales des actes juridiques comme la capacité.
Ce nouveau régime créé cependant des interrogations. Aussi peut-on se demander si une compensation dont les conditions sont réunies avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective et qui n’a pas été invoquée à ce moment là pourrait l’être après.
La compensation s’exerce entre dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles, (1347-1).
La compensation peut être prononcée par le juge (1348). L’avantage de cette compensation judiciaire est que le juge peut prononcer la compensation de dettes n’ayant pas tous les caractères précités et plus exactement la liquidité et l’exigibilité.
La réforme consacre ensuite la compensation de dettes connexes pour des obligations réciproques, celle-ci étant réputée se produire à la date d’exigibilité de la plus ancienne des obligations (1348-1), le juge ne pouvant dès lors refuser une telle compensation car l’une des deux dettes ne serait pas liquide ou exigible.
Enfin la compensation peut être conventionnelle (1348-2), le seul impératif étant que les dettes soient réciproques, les parties ne pouvant y déroger tout comme le juge dans la compensation judiciaire. En revanche et c’est là l’intérêt de la compensation conventionnelle, les parties peuvent rendre certaine et fongible des dettes qui ne le seraient pas. La compensation conventionnelle s’opère à compter de la date de l’accord ou pour des obligations futures à celle de leur coexistence.
6. Les quasi-contrats
L’article 1300 vient donner une définition générique des quasi-contrats : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. »
Il résulte de cette définition que le quasi-contrat n’est pas un contrat pas plus qu’il n’est un engagement unilatéral de volonté. En effet il n’est pas un accord de volontés, pas plus qu’il est une manifestation unilatérale de volonté rendant débiteur celui qui a manifesté la volonté de s’engager car un tiers est engagé.
La définition donnée est suffisamment large pour permettre à la jurisprudence de créée d’autres quasi-contrats à l’instar de ce qu’elle fit en 2002 avec les loteries publicitaires. La réforme entend ainsi consacrer les quasi-contrats comme une source autonome d’obligations amenée à être développée par la jurisprudence.
La réforme reprend ensuite les quasi-contrats classiques et, sans les modifier profondément, les modernise un peu.
La gestion d’affaire est ainsi modernisée à l’article 1301. Il s’agit de : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
Les critères classiques de l’intervention volontaire et utile sont repris et ne nécessitent pas plus d’explication. En revanche le dernier critère pose lui plus de questions. Si la gestion d’affaire effectuée à l’insu du maître ne pose pas de difficulté celle effectuée sans opposition de sa part en pose en revanche un problème de qualification. N’est-on pas dans une telle hypothèse dans un mandat tacite admis par la jurisprudence (Cass. civ. 1re, 22 oct. 1996, n° 94-15.613.)
La réforme aligne ensuite le régime de la gestion d’affaire sur celui du contrat de mandat. La gestion d’affaire est donc un quasi mandat, qui, si elle est acceptée par le maître devient d’ailleurs un contrat de mandat à part entière.
Concernant le paiement de l’indu l’ordonnance reprend majoritairement les anciennes dispositions du code civil et n’apporte rien de nouveau si ce n’est une nouveauté terminologique bienvenue puisque l’on ne parle plus désormais d’action en répétition de l’indu mais en restitution.
Quant à l’enrichissement sans cause, la cause n’existant plus, il est devenu l’enrichissement injustifié. Le législateur a consacré la jurisprudence existante en la matière et maintien la subsidiarité de cette action aux deux précédentes et à la responsabilité civile, l’enrichissement sans cause n’intervenant dès lors qu’en dernier recours.
7. La preuve
Les règles générales du droit de la preuve restent inchangées et sont rappelées aux articles 1353 et suivants du code civil.
Si globalement cette partie n’apporte rien de nouveau par rapport aux dispositions précédentes, tout au plus peut-on noter la consécration du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à lui-même à l’article 1363, il est tout de même à noter un apport majeur puisque la réforme fait entrer l’acte contresigné par l’avocat dans le code civil à l’article 1374 du code civil :
« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
L’acte contresigné par avocat avait été créée par la loi du 28 mars 2011, mais bien qu’ayant fait beaucoup de bruit, celui-ci est demeuré finalement assez peu utilisé.
Aussi, sa consécration dans le code civil vient favoriser son développement puisque ne sont plus énumérés dans le code civil que le seul acte sous seing privé et l’acte authentique.
L’acte contresigné par avocat est un acte sous seing privé qui vient attester uniquement de la qualité des parties. Mais son grand avantage est que comme l’acte authentique, pour contester un tel acte, il faux engager la procédure de faux, très lourde, prévue par le code civil. Donc sur cet aspect l’acte contresigné par avocat et l’acte authentique ont même force probante.
Ce qui manque toujours l’acte contresigné par avocat par rapport à l’acte authentique c’est la date certaine et la force exécutoire, la première pouvant toutefois être obtenue par le procédé de l’horodatage sur la plateforme du Conseil National du Barreau.
La grosse différence est donc la force exécutoire. Mais un pas de plus a été effectué avec la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel contresignés par avocats, sans juge et enregistré par notaire, le contrôle effectué par celui-ci n’étant que purement formel.
Les notaires souhaitaient imposer la présence des parties et le contrôle du contenu de l’acte au législateur pour affirmer que la c’était bien leur validation qui donnait force exécutoire à l’acte et non la rédaction par ceux-ci des avocats.
Le garde des sceaux rappela pourtant bien dans son communiqué du 27 décembre 2016 qu’il n’appartenait pas au notaire de remplir l’office du juge et que ni les parties, ni les avocats n’avaient à se présenter devant lui.
